Construire des classes inclusives : réflexions et pratiques issues du terrain
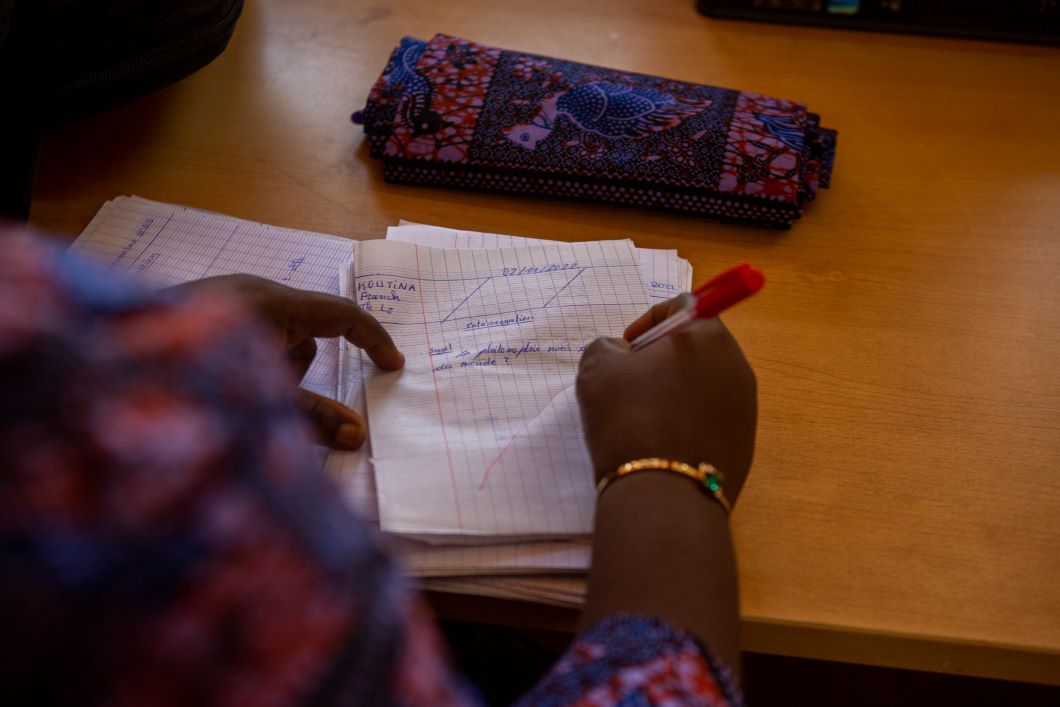
Témoignage de Mariam, au Burundi
Je m’appelle Mariam, je fais partie du personnel d’encadrement pédagogique. Récemment, j’ai observé un groupe de personnes enseignantes dans une école primaire publique à Bujumbura. J’ai constaté que plusieurs ne savent pas toujours comment réagir face à la diversité des situations vécues en classe.
Dans cette école, de nombreuses personnes accompagnent des élèves qui rencontrent des difficultés en lecture et en écriture. Certaines et certains ne reconnaissent pas toutes les lettres, d’autres ne comprennent pas ce qu’ils ou elles lisent. La personne enseignante tente de les soutenir, mais avec un grand nombre d’élèves, il est difficile de leur accorder du temps individuellement.
Certaines classes comptent des élèves très turbulents, qui interrompent fréquemment les activités, ce qui complique l’enseignement. Plusieurs personnes enseignantes ne savent pas comment intervenir face à ces comportements.
Dans une classe, un élève ayant une déficience visuelle est très motivé, mais éprouve des difficultés à suivre les activités écrites. Malheureusement, il n’y a pas de matériel adapté pour cet élève.
Après avoir observé ces éléments, et en m’appuyant sur mon expertise acquise au fil de plus de dix années d’encadrement pédagogique, ainsi que sur les bonnes pratiques partagées par mes collègues dans plusieurs écoles, j’aimerais proposer, avec eux, des pistes concrètes pour soutenir le personnel scolaire.
Des solutions possibles
Former des petits groupes selon les besoins
Lors d’une visite dans une école de Kanyosha, juste à côté de Bujumbura, j’ai assisté à une séance de mathématiques en CE2 qui m’a vraiment frappée. L’enseignant, M. Ndayishimiye, avait organisé sa classe en petits groupes pour s’adapter aux besoins de chacun. J’ai d’abord vu un groupe d’élèves qui avaient du mal avec la multiplication. Ils manipulaient des graines locales pour comprendre des calculs simples comme trois fois quatre. Chacun formait trois tas de quatre graines, recomptait plusieurs fois et notait le total sur son ardoise.
À côté, un autre groupe, un peu plus avancé, travaillait sur des cartes en carton avec des multiplications comme deux fois cinq ou quatre fois trois. Les élèves se corrigeaient entre eux en regardant un petit tableau affiché au mur. Les élèves les plus à l’aise inventaient de petites devinettes, par exemple : “Si trois élèves ont chacun quatre crayons, combien de crayons ont-ils en tout ?” et posaient les questions aux autres pour vérifier qu’ils avaient bien compris.
Ce que j’ai trouvé remarquable, c’est qu’avec un peu d’organisation et du matériel très simple, chaque élève peut avancer à son rythme, même dans une grande classe.
S’inspirer de la conception universelle de l’apprentissage (CUA)
Avec autant d’élèves en classe si différents les uns des autres, il pourrait être gagnant de s’inspirer des lignes directrices de la CUA. Pour en connaître davantage, cliquez ici.
En visitant une classe de 6e à Gihosha, j’ai remarqué que M. Nshimirimana a tenu compte de la conception universelle de l’apprentissage. Ce dernier voulait travailler le texte narratif en s’assurant de rejoindre le plus d’élèves. Pour présenter ce qu’est le texte narratif, sa structure et les éléments qui le composent, M. Nshimirimana a trouvé une petite capsule explicative sur internet, qu’il a présenté en classe. Par la suite, M. Nshimirimana a présenté une carte conceptuelle, qui présentait la structure du texte narratif. Lorsqu’est venu le moment de réaliser le texte narratif, les élèves ont pu décider du mode de présentation de ce texte : par écrit, l’expliquer à l’oral, réaliser un enregistrement audio, réaliser une affiche qui soutient son texte.
Encourager l’entraide entre élèves
Certains élèves plus avancés peuvent soutenir ceux qui ont plus de difficulté. Ce pairage développe la solidarité et permet aux élèves de progresser et de réaliser des apprentissages. À ce sujet, j’ai observé une classe de 5e dans la ville de Kinindo. Après avoir réalisé un exercice d’écriture, Mme Uwimana a formé des groupes de plusieurs élèves. Ces derniers avaient chacun un rôle : correcteur, conseiller, lecteur. Chaque élève devait lire son travail et ses compagnons l’aidaient à améliorer sa production.
Accompagner l’élève ayant une déficience visuelle
Malgré sa déficience visuelle, le petit Salif est très motivé à apprendre. Cependant, son professeur est très occupé avec le groupe et n’a pas toujours le temps de s’occuper de Salif. Il a donc décidé de désigner quelques élèves volontaires pour aider Salif à suivre les consignes, lire les textes à voix haute ou lui expliquer les activités. Cela valorise les élèves aidants tout en favorisant une inclusion pour Salif.
Donner des responsabilités aux élèves plus turbulents
Dans une école de Musaga, un instituteur m’a parlé d’un élève très remuant, Abdoul. Au lieu de le punir, il en a fait le “gardien du matériel” : Abdoul distribuait les ardoises et rangeait les cahiers. Il avait aussi un petit galet dans sa poche : quand il se sentait trop nerveux, il le posait sur son bureau pour signaler à l’enseignant qu’il avait besoin de bouger. Cette idée simple a suffi pour apaiser la classe.
Les enfants qui ont du mal à se concentrer peuvent être valorisés en leur confiant des rôles : distribuer le matériel, aider à ranger, écrire au tableau… Cela les aide à se sentir utiles tout en créant une relation positive entre la personne enseignante et l’élève. Il est aussi possible que certains enfants aient besoin de temps de repos ou au contraire d’un temps pour se dépenser s’ils ont des troubles de l’attention par exemple; et simplement de leur offrir la possibilité de signaler à l’enseignant leur besoin (avec un carton rouge par exemple), de faire un tour dans la cour, d’utiliser un objet anti-stress (comme une balle en mousse, un élastique, ou un bouchon à manipuler discrètement) ou d’aller se calmer dans un coin dédié.
Analyse des expertes et experts APPRENDRE
Pour le Groupe Thématique d’Expertise “Genre et inclusion”, les difficultés rencontrées par Mariam se retrouvent dans toutes les écoles du monde, car les apprenantes et apprenants sont tous uniques et ont tous des besoins différents. Des ressources additionnelles sont toujours bienvenues, mais fait-on un bon usage des ressources existantes?
Les enseignantes et enseignants peuvent mobiliser de façon plus systématique les techniques qu’ils connaissent déjà (ex. l’approche centrée sur l’enfant, la différenciation, le travail en groupe, etc.) qui permettent un enseignement plus inclusif. Les élèves sont eux-mêmes une ressource pour aider le personnel enseignant, ce qui est peu utilisé dans les écoles. C’est aussi pour les élèves un avantage académique, car en aidant leurs camarades, les élèves renforcent leurs propres connaissances. Ne dit-on pas que “le meilleur moyen d’apprendre, c’est d’enseigner” ?
Enfin, la Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA) vise à créer des environnements d’apprentissage inclusifs et équitables pour tous, en anticipant la diversité des besoins des apprenantes et apprenants, en supprimant les obstacles inutiles et en améliorant l’accès de toutes et tous. Beaucoup de pratiques peuvent venir aider le personnel enseignant : jumelage, sous-groupe, variété dans l’enseignement et les approches, permettre de choisir les thématiques, varier les présentations de travaux etc. Cependant, il importe de bien utiliser les ressources et de soutenir le personnel enseignant dans l’instauration de ces modalités de travail.
Peu importe le nombre de ressources, si elles ne sont pas bien utilisées, ce ne sera jamais assez !
Pour aller plus loin
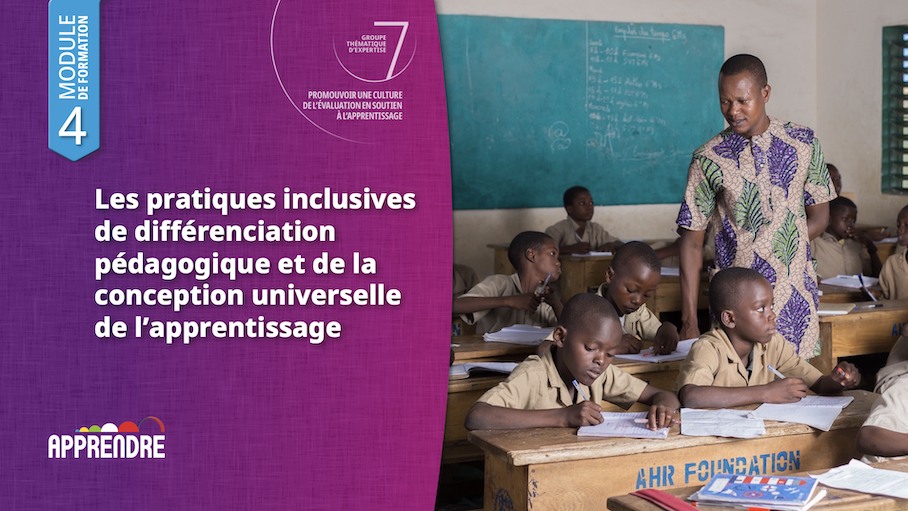
Saviez-vous que…
Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes.



